Travail, aliénation et communication pathologique
Mireille Lévy, 9 mars 2019
A. Notes préparatoires, démarche et
bibliographie
B. Exposé du 9 mars
A. Notes préparatoires, démarche et bibliographie
Notre réflexion sur la dialectique nous a amenés à nous pencher sur le sens ou le non-sens des communications qui nous sollicitent et tout particulièrement à nous intéresser aux phénomènes d’effondrement dans le non-sens. Nous sommes partis de la théorie de la communication de Watzlawick qui a mis en évidence le caractère pathogène de certaines manières de communiquer, dont les phénomènes de double contrainte et de déni sont les exemples phares. Je me propose d’analyser les phénomènes d’effondrement du sens et d’aliénation dans la sphère du travail en utilisant la théorie de la communication de Watzlawick et d’y repérer les aspects de communication pathologique. Nous terminerons cette réflexion en soulevant la question des changements 1 et 2 dans la sphère du travail.
Etapes de la démarche
1. On peut thématiser le travail d’un double point de vue, sur le plan de l’existence personnelle comme problème existentiel d’une part, sur le plan d’une forme historique d’organisation socio-économique, d’autre part. Je tenterai de montrer l’intérêt qu’il y a à conserver la distinction de ces deux plans et à poser le problème de leur articulation.
En abordant le travail comme problème existentiel, je mettrai en évidence quelques points de divergences ou de convergences entre différentes manières de lier travail et compréhension de soi, dont celle de la foi chrétienne, celle du militantisme humaniste athée et celle véhiculée par l’idéologie managériale.
2. Le problème de l’aliénation ayant souvent été posé à travers celui d’un manque de reconnaissance, je tenterai brièvement de mettre en évidence quelques ambiguïtés liées à ces notions de quête de reconnaissance, d’attente de reconnaissance et d’exigence de reconnaissance. La référence à la philosophie de l’existence et à la réflexion sur la communication me permettra de mettre en évidence la perturbation de la communication induite par certaines formes de quête de reconnaissance.
3. J’aborderai ensuite le plan du travail au niveau de son organisation socio-économique actuelle. Le passage du capitalisme tayloriste, fordiste, à sa forme actuelle, marquée par les nouvelles conceptions managériales, est l’objet d’un débat entre sociologues et économistes. Cependant grand nombre d’auteurs, ergonomes, sociologues, économistes, se rejoignent dans la désignation de certaines caractéristiques de l’organisation actuelle des entreprises et des organisations publiques. Cette conception actuelle, d’orientation néo-libérale, marquée par la flexibilisation, le lean-management, le toyotisme et l’évaluation personnalisée, est souvent présentée comme un changement radical par rapport au fordisme, puisqu’elle revendique la rupture avec les rapports hiérarchiques, l’appel fait au pouvoir d’initiative des travailleurs, l’importance donnée à l’estime de soi et à la confiance, le soin apporté à la communication; tant d’aspects qui rendraient désuètes les critiques souvent faites depuis Marx au capitalisme, comme quoi cette forme d’organisation économique empêcherait le salarié de donner sens à son travail, la division du travail généralisée par le capitalisme générant l’aliénation du travail et l’atomisation des liens sociaux. Ce néomanagement a produit toute une rhétorique, qui se développe autour de l’accomplissement de soi dans le travail, la communication vraie, l’excellence, le service au client-roi, l’entrepreneur de soi, l’esprit compétitif et le dépassement de soi.
4. En me basant sur des enquêtes et travaux de sociologie, sur des observations de psychologues du travail et de cliniciens du travail[1], je présenterai les nouvelles formes de souffrance et d’aliénation au travail dues aux nouvelles formes de l’économie et du néomanagement, souffrances qui touchent toutes les catégories de métier, les cadres comme les ouvriers peu qualifiés. Au-delà des souffrances dues à l’intensification des rythmes de travail, de nouvelles formes de souffrance apparaissent : celles liées au travail empêché (mal fait par obligation), à la destruction des métiers et au mépris des expériences et du savoir-faire professionnel, celles dues à la compromission avec des procédés d’exclusion et de mobbing de collègues, et enfin celles dues à la soudaine découverte que l’entreprise n’a ni mémoire, ni reconnaissance pour les efforts fournis, et congédie sans états d’âme ceux qui lui ont donné leur vie. Je dégagerai leurs conséquences au niveau de la communication, par ce que Habermas appelle la colonisation du monde vécu.
5. Je caractériserai alors la communication prônée par le néomanagement de communication pathologique en suggérant qu’elle ne s’arrête pas aux portes des entreprises, mais qu’elle suscite une pathologisation de la communication au 2e palier. J’emprunte cette notion à Marc-André Freudiger [2]. Au premier palier, la communication est pervertie dans les rapports interpersonnels, par le mensonge, le déni, le mépris, la double contrainte. Au second palier, c’est le rapport réflexif que la société entretient avec elle-même qui est en jeu, la corruption atteint les institutions et procédés censés protéger contre cette dérive. Or « l’impossibilité de parvenir à un authentique jugement réflexif signifie la fin de toute justice possible ».[3] Marc-André Freudiger fait remarquer que ce passage à une communication pervertie au deuxième palier n’est pas forcément le fait de cyniques qui bafoueraient volontairement les principes de justice, mais de ceux qui, voulant éradiquer l’injustice, ne parviennent pas à reconnaître leur échec. Cela pourrait aussi, me semble-il être le fait de ceux qui ayant été amenés à pratiquer une forme d’injustice qui dans le cadre de la communication pervertie est présentée comme la justice, préfèrent s’entêter dans cette fausse représentation plutôt que de reconnaître leur culpabilité. Mais cette attitude peut soudain déboucher sur une crise majeure, car le poids de la culpabilité ne se laisse pas si facilement oublier. (H.Baruk)[4].
La communication pathologique au deuxième palier induit au niveau de la définition même de la raison et de la légitimité, un effet semblable à celui que Zinoviev décrit dans « Les Hauteurs béantes » ou dans « L’Avenir radieux », soit la mise en place d’une perversion généralisée de la communication assez proche de ce que Sigaut appelle une aliénation culturelle, un délire collectif, où il est très difficile de faire valoir une objection, le déni du réel étant systématique et auto-alimenté.
6. Je conclurai en revenant au plan existentiel, pour poser la possibilité d’un changement 2, alors que le système, maintenu en partie par une aliénation-servitude consentie, pourrait donner l’impression d’être une broyeuse. Je ferai référence à un film de Jean-Marc Moutout, intitulé De bon matin (2011) pour revenir à la question du changement 2.
1 Cf. bibliographie ci-dessous, mais
en particulier : Christophe Dejours, YvesClot, Valérie Brunel,
Luc Boltanski et Eve Chiapello, Christian Laval, Isabelle Bruno,
Richard Sennet, Danièle Linhart, H.Kocyba
2
Marc-André Freudiger, in Le rôle-clé de l’éthique de la
communication pour la société, in La communication bafouée, Les
accords d’Helsinki et les Eglises, Labor et Fides, 1985, cf. extrait
ci-dessous
3 Ibid. p.24
4 H. Baruk, psychiatre a développé
l’idée que la transgression des principes de justice suscitent une
culpabilité génératrice, quand elle est refoulée, de souffrance
psychique, pouvant aller jusqu’à la maladie mentale, non à cause
d’un phénomène de répression sociale des désirs, mais parce que la
réponse à l’exigence de justice est une condition du rapport à soi,
compris comme rapport à une histoire sensée.
Bibliographie
Marc-André Freudiger, in Le Rôle-clé de l’éthique de la communication pour la société, in La communication bafouée, Les accords d’Helsinki et les Eglises, Labor et Fides, 1985
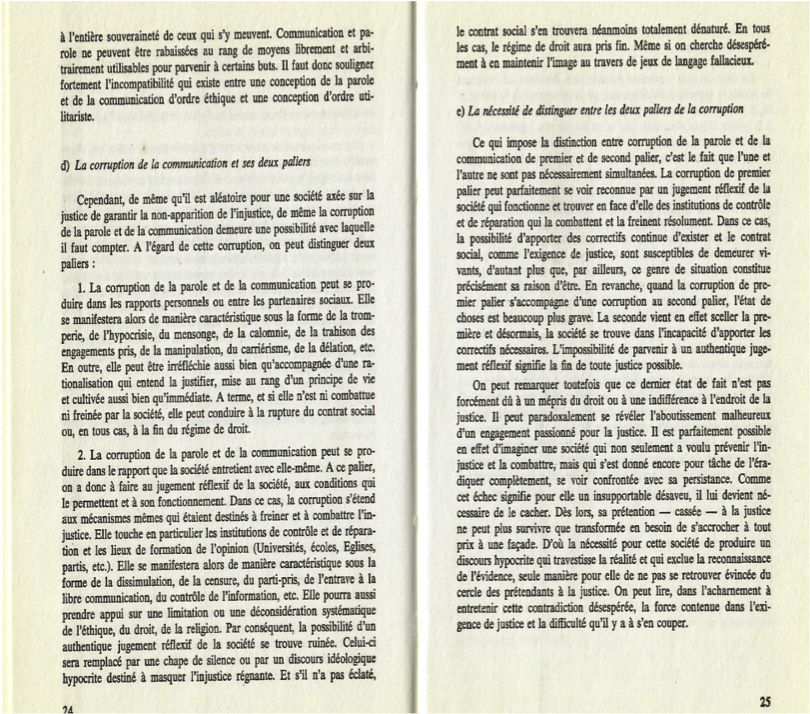
Luc Boltanski, Eve Chiapello, Le Nouvel esprit du capitalisme, Gallimard, 1999
Christophe Dejours, Souffrance en France, la banalisation de l’injustice sociale, Seuil, 1998
Christophe Dejours, La Panne, Repenser le travail et changer la vie, 2012
C. Dejours Aliénation et clinique du travailhttp://www.cairn.info/revue-actuel-marx-2006-1-page-123.htm
Yves Clot Le Travail à cœur, pour en finir avec les risques psychosociaux, La Découverte, 2010
Richard Sennett, Le Travail sans qualités : les conséquences humaines de la flexibilité, Paris, Albin Michel, 2000.
Danièle Linhart, La Comédie humaine du travail, Erès, Sociologie clinique, 2015
• Isabelle Bruno, Pierre Clément, Christian Laval, La Grande mutation, néolibéralisme et éducation en Europe, Pierre Dardot, Christian Laval, La Nouvelle raison du monde, essai sur la société néolibérale, Syllepse, 2010
• Nicole Aubert et Vincent de Gaulejac, Le coût de l’excellence, nouvelle édition, Seuil, 200, (1991)
• H. Kocyba, Didier Renaut, Reconnaissance, subjectivisation, singularité, trad. D. Renault, Revue Travailler https://www.google.ch/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwia5p-KxebOAhXsL8AKHQyLCPMQFggeMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.cairn.info%2Frevue-travailler-2007-2-page-103.htm&usg=AFQjCNHVU-5QlTVfxGqkGH7q5m9IX2CNgQ&sig2=Jq_6i1888wGllKFzrywyyQ
Valérie Brunel, Les Managers de l’âme, le développement personnel en entreprise, nouvelle pratique de pouvoir ? La Découverte, Poche, 2004
Dider Bille DRH La Machine à broyer, recruter, casser, jeter
DVD La Mise à mort du travail de Jean-Robert Viallet et Christophe Nick FranceTv.com Reportages en 3 volets La destruction, l’aliénation, la dépossession, les volets 1 et 2 sont accessibles en lignehttps://youtu.be/n7LWLNR6F7I
DVD L'enfance sous contrôle, documentaires solidarité santé https://www.google.ch/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi34oa4vfjgAhUAxMQBHWLHAUYQwqsBMAF6BAgAEAc&url=https%3A%2F%2Fvimeo.com%2F229420416&usg=AOvVaw15DbhcaRS8Xr2YmVFv3E5A en vimeo
DVD Graines de délinquants, Philippe Meirieu et alii ) [1] http://www.youtube.com/watch?v=f-dMdQYQAMc
Film de Jean- Marc Moutout, De Bon matin, (2011)
DVD Ils ne mouraient pas tous mais tous étaient frappés, film de Sophie Bruneau et Marc-Antoine Roudil.Bodega
J’ai très mal au travail , film documentaire de Jean-Michel Carré, accessible en ligne https://youtu.be/nD3mu8UjIvc
Christian Laval, L’Ecole n’est pas une entreprise, La Découverte, Poche, 2003,2004
Isabelle Bruno, Pierre Clément, Christian Laval, La Grande mutation, néolibéralisme et éducation en Europe, Syllepse, 2010
Vincent de Gaulejac, La Société malade de sa gestion, Seuil, 2005/2009
Nicole Aubert, Vincent Gaulejac, Le Coût de l'excellence, éd. 1991 Seuil
Article en ligne : La stratégie de Lisbonne et l'éducation de Christian Laval
La nouvelle stratégie de l'OCDE (1999, article en ligne par un membre d'Attac, Yves Bauney) présentation des perspectives sur l'éducation, dans la ligne « apprendre tout au long de la vie » et les conséquences sur le nouveau rôle des enseignants (chapitre III)
Coll. Pas de zéro de conduite pour les enfants de trois ans, Enfants turbulents, l'enfer est-il pavé de bonnes intentions ? (Le Collectif pas de zéro de conduite a lutté contre les dérives sécuritaires de dépistage, il a reçu la validation de son action par le Comité national d'éthique, et a gagné dans le débat intellectuel sur ce type de prévention dans son débat avec l'Institut national de recherche des sciences médicales INSERM )
---oOo---
B. Exposé du 9 mars
Introduction : La question
Je me propose d’analyser les phénomènes d’effondrement du sens et d’aliénation dans la sphère du travail en utilisant la théorie de la communication de Watzlawick et d’y repérer les aspects de communication pathologique. Nous terminerons cette réflexion en soulevant la question des changements 1 et 2 dans la sphère du travail.
On ne peut se pencher sur les phénomènes d’aliénation et de non-reconnaissance dans la sphère du travail sans se situer par rapport aux analyses du courant marxiste. Marx a développé une lecture critique du capitalisme sous le double aspect de l’exploitation et de l’aliénation des salariés. L’aliénation est développée par le courant marxiste comme impossibilité de donner du sens au travail dans le cadre d’une économie capitaliste, thèse soutenue par deux arguments ;
- la division du travail, sous la forme exemplaire du taylorisme transforme l’humain en rouage d’une grande machine aveugle, comme l’a suggéré Chaplin dans les Temps modernes,
- l’orientation de la production vers la production de marchandises selon le critère du profit plutôt que celui de l’usage et de sa destination sociale, brise les conditions de la reconnaissance atomise et réifie les relations sociales.
Mais, à l’encontre de ces thèses, le capitalisme postfordiste prétend avoir quitté le modèle taylorien et reposer sur une nouvelle organisation du travail, plus axée sur l’élément humain, (selon le titre de l’ouvrage de Will Schutz,[6] fondateur de ce néomanagement) ainsi que s’appuyer sur des relations fortes d’équipes ; cette nouvelle conception du travail prétend intégrer la dimension subjective du travail, pouvoir réconcilier aspirations personnelles et vie professionnelle, voire travail et bonheur, en appeler à la sagacité, voire la créativité des salariés, ouvrant ainsi la possibilité d’une satisfaction intrinsèque et d’une authentique reconnaissance.
Ma réflexion soulève les questions suivantes :
- Ce changement d’organisation du travail, donne-t-il lieu à des modifications de la communication ?
- L’extension du modèle managérial dans le secteur public a-t-il des conséquences au niveau de la place reconnue à la parole dans la société, y a-t-il, par le biais des transformations de la communication, ce que Habermas dénonce comme une colonisation du monde vécu par le système économique ?
Ma présentation d’aujourd’hui ne prétend à rien d’autre que d’ouvrir quelques pistes d’interrogation, de susciter quelques doutes face à des manières d’organiser le travail considérées comme évidemment pertinentes.
Je commencerai par quelques remarques sur le thème du travail, puis étant donné l’importance que prend actuellement le thème de la reconnaissance dans la sphère socio-professionnelle, j’enchaînerai par quelques considérations relatives à la notion de reconnaissance. La référence à la philosophie de l’existence et à la réflexion sur la communication me permettra de mettre en évidence la perturbation de la communication induite par certaines formes de quête de reconnaissance. Je passerai ensuite à l’étude de ce que devient la communication dans la forme actuelle de l’organisation du travail marquée par le néolibéralisme.
1. Le travail : deux axes d’étude
L’importance que je donne à la lecture critique de la forme actuelle du travail sur le plan économico-social ne doit pas occulter le fait que le rapport au travail est aussi une question existentielle, une dimension de l’existence où se joue la compréhension de soi. L’individu a à prendre des décisions quant à ce qu’il fait de cette dimension et est placé devant des alternatives de sens de l’existence : le rapport au travail engage des choix quant au sens ou à la vanité de nos efforts, quant à l’espérance de vaincre le mal ou de résister au mal, enfin le rapport au travail est aussi pris dans le projet confus d’un être qui se cherche et se fuit.
1.1. Le travail peut être thématisé en tant que solution donnée par une société à ce qui relève de la prise en charge de la réalité et de la lutte contre le mal-être qu’elle nécessite. Il peut s’agir tant de l’éducation des enfants, que de la production de nourriture, de vêtements, d’habitats, de moyens de communication, des services, de l’aide aux êtres fragilisés, malades, vieux. Dans cette perspective, le salariat, l’opposition entre le travail et les loisirs, les formes de la famille nucléaire, peuvent être lues comme des modalités historiques et comme intégrées à un système économico-social. Certaines formes d’organisation du travail peuvent être désignées comme génératrices de souffrances, d’injustices, d’aliénation, de réification.
1.2. Mais le travail peut aussi être thématisé comme problème existentiel, comme composante de la compréhension de soi, : la prise en charge de la dimension incarnée et matérielle de la vie, non seulement de soi, mais aussi d’autrui, des générations à venir, peut être interprétée de différentes manières : le travail est-il saisi comme une dimension de vie qui engage ma responsabilité ou comme un lieu annexe de l’essentiel, (ainsi que le vit l’adepte de la contemplation ou de opposé à l’hédonisme), comme le lieu de l’accomplissement de la personne, comme un moment imposé au-delà duquel se trouverait la liberté, comme le lieu d’où l’humanité pourra trouver son accomplissement ? La perspective existentielle n’est pas réductible à un effet idéologique de l’organisation sociale même si certaines formes d’organisation du travail génèrent des idéologies quant au sens du travail. Ainsi le néolibéralisme génère une conception de la réalisation de soi à travers la carrière professionnelle, une illusion d’accomplissement de soi à travers la reconnaissance sociale par l’intermédiaire d’un pouvoir (financier ou autre) accru. Mais la distinction entre la perspective existentielle et la perspective sociologique reste opérante dans la mesure où la démarche existentielle permet une prise de distance à l’égard de cette conception du soi qui s’avère illusion dans la souffrance qu’elle génère, comme destruction du rapport éthique à soi. Le rapport au travail peut être l’occasion d’un divertissement au sens de Pascal, d’une fuite de soi, ou d’une affirmation de soi dans la maîtrise, tant de formes de vie qui compromettent la liberté existentielle.
1.3. La dimension pratique est toujours enveloppée par une dimension relationnelle, une manière de communiquer, ce qui renforce l’impossibilité de séparer totalement le niveau pratique du niveau de la conception existentielle.
1.4. Du point de vue existentiel, le rapport au travail varie selon la manière dont on conçoit la possibilité de vaincre le mal dans l’histoire, selon l’importance que l’on donne à la vie sociale, selon que l’on prétend la vie rivée au vouloir-vivre ou que l’on reconnaît un devoir-vivre, soit que l’on reconnaît des exigences, comme celle de vérité ou de justice, qui s’imposent à la conscience. Au niveau existentiel, le rapport de l’individu au travail engage sa manière de répondre à la question de l’espérance, ce qui a une incidence quant à la manière de relier le proche et le lointain, le présent et le futur.
1.5. Dans la perspective de la foi chrétienne, le travail n’est pas le lieu de l’accomplissement de soi ou de l’humanité, mais un des lieux de la résistance au mal, de réponse à un appel, à l’exigence de prendre soin d’autrui. La réalité historique, matérielle, incarnée, de la vie est prise au sérieux dans le mouvement paradoxal de la foi : en même temps que renoncement à faire du fini le lieu de l’accomplissement de soi, il est retour au fini pour prendre en charge l’existence concrète dans son historicité.
1.6. Le marxisme tout en critiquant la notion de travail salarié tel qu’il fonctionne dans le contexte du capitalisme et l’opposition qu’il génère entre travail et loisir, vie sociale et vie privée, fait du travail, qui prendra en charge sa dimension de destination sociale, et sa dimension de créativité, le mode de l’accomplissement humain, de l’instauration d’un monde sensé, juste et authentiquement humain.
1.7. La perspective chrétienne peut conduire à lutter contre des formes d’exploitation et d’aliénation, mises en évidences par l’analyse économique marxiste, sans partager l’espoir prométhéen quant à l’émancipation de l’humanité et sans accepter l’englobement de la parole dans la praxis sociale. La résistance à l’aliénation ne s’identifie pas à la lutte pour l’émancipation.
2. La reconnaissance : apport de la philosophie de l’existence
2.1. Dans le cadre des rapports à autrui on parle d’un rapport de reconnaissance quand on veut signifier que les rapports ne sauraient être réduits à des rapports stratégiques de pouvoir, que les relations entre personnes engagent la problématique de la liberté, liberté qui est perdue, quand elle est interprétée comme affirmation de maîtrise.[7]
Dans le cadre de la philosophie de l’existence, reconnaître autrui, c’est reconnaître une liberté, une présence qui engage ma responsabilité et une limite qui me somme (Levinas emploie le terme juridique d’assignation) de rendre compte de ce que je fais de ma force face à sa vulnérabilité, de la manière dont je réponds ou pas à son appel. En ce sens, reconnaître un enfant, ce n’est pas seulement le reconnaître comme être de besoin, c’est reconnaître que sa vulnérabilité ne m’autorise pas à m’emparer de sa liberté, de son avenir. Cette reconnaissance-là ne consiste pas à être témoin d’une particularité individuelle mais à inscrire l’interaction dans une perspective ouverte, de confiance. Reconnaître autrui, c’est le respecter comme centre d’initiatives et d’interprétation, comme destinataire de paroles, comme interlocuteur incarné. La reconnaissance de la liberté est inséparable des conditions minimales de sens dans la communication. L’indifférence, le mépris sont destructeurs. L’impossibilité d’être reçu, reconnu comme émetteur d’un discours sensé, le déni systématique des intentions dans la communication sont pathogènes, comme l’ont montré Laing, Esterson et Watzlawick dans leurs descriptions de la communication pathologique. La reconnaissance est censée laisser l’avenir ouvert dans un climat de confiance et non statuer sur des réalisations passées.
Watzlawick souligne le fait qu’une part considérable et certainement la plus humanisante de la communication est celle par laquelle nous nous confirmons les uns les autres dans notre identité. Mais cette reconnaissance n’est pas refermée sur une identité idem, elle est reconnaissance ouverte d’une présence dont l’identité se joue aussi dans la relation, nous atteint et nous concerne par sa présence et sa propre quête de justification. On ne dispose pas d’une identité comme somme de qualités à exprimer et faire reconnaître, le soi n’existe que comme interprétation- récit des multiples interactions où se joue et se risque la liberté. Refermer l’identité sur un ensemble de qualités observables va à l’encontre de la reconnaissance.
2.2. A l’encontre de l’avis de Foucault, comme quoi les demandes de reconnaissance ne sont que le résultat d’effets de subjectivation d’institutions particulières, je considère avec la philosophie de l’existence que l’attente de reconnaissance est intrinsèquement liée à la quête de compréhension de soi qui elle-même ne peut avoir lieu que dans l’interaction avec autrui, interlocuteur ou visage qui interpelle. La quête de reconnaissance est liée à la quête de justification, dont il est bien difficile de se défaire, les idées nous interpellent, nous réclament, comme le rappelait Socrate à ses juges. La question de la quête de reconnaissance devient alors : devant quelle instance vais-je tenter de me justifier ? Devant le tribunal de l’histoire, devant Dieu ? La quête de reconnaissance de ma valeur se heurte au problème du choix du témoin et de sa consistance.
2.3. La psychologie peut décrire l’importance de l’atmosphère de confiance et de dialogue, l’importance de relier autonomie et mutualité, les dégâts opérés par le déni, l’aliénation, la domination, la dérision, l’angoisse comme atmosphère de la liberté. Mais les conditions d’accès à une reconnaissance vraie, la possibilité d’une relation de confiance à autrui, d’une authentique compréhension de soi, fait l’objet du débat doctrinal, débat au sujet des convictions du troisième degré.
3. Reconnaissance dans le travail et estime sociale
3.1. Critiques de la conception de Honneth et reformulation de la notion de reconnaissance dans la sphère du travail
Honneth distingue trois sphères de reconnaissance : l’amour, où s’acquiert la confiance en soi, le droit, où se joue le respect de soi et la sphère sociale où se joue l’estime de soi.
Honneth reprend les analyses de Winnicott sur le développement de l’enfant dans l’interaction avec sa mère pour justifier l’idée que l’amour est un mode de la reconnaissance. Le soi ne peut émerger que dans l’interaction et sur la base du renoncement à la toute-puissance et de l’expérience que la reconnaissance de l’autonomie ne signifie pas l’abandon.
Honneth met en évidence l’importance de la reconnaissance juridique, à l’opposé de la conception de Marx. Pour Marx en effet, le droit est un voile posé sur la réalité, un masque sur les rôles sociaux, ce qui est le point faible de la théorie politique marxiste, même si l’on en vient à critiquer la notion de contrat de travail tel qu’il fonctionne dans le contexte du capitalisme.
Par contre la manière dont A. Honneth veut compléter la reconnaissance juridique par celle de l’estime sociale me semble poser problème, particulièrement dans un aspect de sa définition de l’estime sociale où il s’agirait d’être reconnu dans la qualité d’une prestation individuelle. Il me semble plus judicieux de limiter le sens de la reconnaissance dans la sphère du travail à celui d’une confiance dans le pouvoir d’initiative de l’autre. Cette confiance peut se traduire par un type de communication et de participation aux décisions dans le monde du travail, à différentes échelles, qui permettent une disputatio sur les orientations économiques, sur l’organisation des services et de la production, confiance qui est aussi appel à la responsabilité de chacun envers autrui.[8]
La visée de valorisation de soi par l’obtention d’une reconnaissance pour une prestation particulière est incompatible avec la prise au sérieux du travail comme service à autrui. On ne peut à la fois accompagner un malade dans la souffrance de l’extrême vulnérabilité et aspirer à être reconnu dans ses exploits de très bon soignant. La communication est tout aussi pathologique pour un faire-valoir de l’enseignant dans la relation pédagogique. Reconnaître l’élève, c’est lui reconnaître le statut de destinataires de paroles et ne pas s’emparer de son avenir, ce qui n’est pas compatible avec la quête d’admiration. Kierkegaard a souvent mis en évidence l’effet comique d’une contradiction entre le contenu d’une activité ou d’un message et la forme de la communication qui en détruit le sens. Dans un contexte idéologique de la communication transparente mise à plat, ce genre de contradictions, prétendre être centré sur la visée du soin et chercher par cela la confirmation de son excellence, ne fait ni rire, ni lever un doute. On ne serait même pas choqué à l’idée d’un Socrate qui organise un concours du meilleur dialecticien.
Au contraire d’une quête de reconnaissance d’une performance individuelle, le climat de confiance qui ouvre à la participation de chacun permet le regard critique sur l’action, soit la reconnaissance des pannes, des failles, des limites du pouvoir.
Cette estime, comme je l’ai redéfinie, confiance dans le pouvoir d’initiative de l’autre et ouverture au dialogue, rejoint le sens du respect de la personne. Dans la sphère du travail et des rôles sociaux, il ne s’agit pas de donner une estime à la mesure des réalisations passées, mais de permettre à chacun d’assumer sa part dans la lutte contre le mal-être, par une invitation à la coopération plutôt qu’à la compétition et à la méfiance. Cette conception de la reconnaissance comme reconnaissance de présence et attitude de confiance dans la l’intersubjectivité pratique pourrait être un socle commun aux défenseurs de la démocratie. Elle laisse ouverte l’interprétation ultime du rapport à la praxis, la reprise dans l’orientation intérieure du sens des œuvres. Une législation du travail, dans le cadre de la Déclaration des droits de l’homme, permettrait d’éviter que l’organisation du travail soit couplée avec une espérance dernière qui serait l’avènement de l’homme nouveau et serait compatible avec l’idée que bien faire son travail est une manière de répondre à un appel, d’endosser la responsabilité de porter une conception des rapports humains où l’arbitraire et la force ne sont pas la norme.
Si j’ai à faire reconnaître quelque chose c’est simplement mon rapport à l’exigence de sens : je ne peux me laisser décharger de la responsabilité à l’égard du sens de mon activité, je ne peux, sans devoir résister, me voir inséré dans un rapport au travail où la destination du travail est niée ou destructrice.[9] Je dois travailler à ce qu’institutionnellement la dimension de destination du travail soit reconnue. Il ne s’agit pas d’interdire le regard systémique sur l’échange au nom de la priorité du travail comme praxis, mais, par exemple, d’utiliser le regard systémique sur la circulation des biens pour ajuster la dimension de destination de la production compte tenu par exemple du problème écologique.
Faire pénétrer la thématique de la reconnaissance dans le monde du travail, loin de rejoindre l’aspiration à valoir par ses performances, signifie l’irruption du respect de la personne, renvoie donc à l’idée d’une législation plutôt qu’à celle de négociation, et marque une rupture avec une conception du travail rivée au vouloir-vivre et à la recherche de puissance, voire de sécurité. La récente réforme du Code du Travail en France impulsée par le président Macron va en sens inverse.
3.2. L’intégration du thème de l’estime sociale à une théorie de la justice : les arguments de Nancy Fraser
Nancy Fraser [10] a développé une argumentation intéressante dans cette perspective (philosophe américaine contemporaine, spécialisée en philosophie sociale et politique qui s’est penchée sur la question féministe et se sent proche de l’Ecole de Francfort, apprécie Habermas tout en développant l’idée d’espace public, elle critique la conception de Honneth). Elle propose de ramener la problématique de la reconnaissance dans une théorie bicéphale de la justice, comprenant le plan de la redistribution-production et celui de la reconnaissance. Elle fait remarquer que la théorie politique de la reconnaissance doit tenir compte de la nécessité de maintenir ouverte la question de la vie accomplie et du bonheur, que la reconnaissance au niveau de l’estime pose un double problème : chacun ne peut être le meilleur d’une part et d’autre part la satisfaction d’un besoin de reconnaissance n’est pas définissable facilement sur le plan psychologique. En effet, de qui puis-je atteindre la reconnaissance de ma valeur personnelle ou de celle de mon action ? Peut-on parier sur le fait que ce besoin de reconnaissance puisse être satisfait ? La plainte de non-reconnaissance est-elle chaque fois légitime ?
Nancy Fraser critique la notion d’estime sociale et toute forme de reconnaissance qui porte sur l’identité. Elle reproche à la politique de la reconnaissance liée à l’identité de se mettre en contradiction avec ses prémisses : partant de l’idée que la non-reconnaissance compromet le rapport à soi qui ne peut se construire que dans l’interaction, cette conception de la reconnaissance axée sur l’identité finit par favoriser le repli dans le communautarisme, la réification et la simplification de l’identité revendiquée, la mettant en quelque sorte hors du dialogue, hors-jeu, bloquée dans son passé. NF fait porter la reconnaissance sur le statut. Elle considère que ce sont des modèles institutionnalisés qui garantissent ou portent atteinte à la reconnaissance. Les institutions ont pour sens de garantir la réciprocité au sens de la parité de participation dans la vie sociale. Remédier au déni de reconnaissance signifie changer les institutions sociales, les valeurs qui sont un obstacle à la parité de participation. Ceci a l’avantage, de déconnecter le problème de la reconnaissance de celui de l’identité. En érigeant la parité de participation en critère normatif, le modèle statutaire soumet les prétentions à la reconnaissance aux processus démocratiques de justification en public. Il valorise l’interaction transculturelle. Il ne s’agit pas de nier ou sous-estimer la stigmatisation de certains groupes sociaux, mais d’appeler à une dynamique de reconnaissance ouverte sur un avenir relationnel. (On trouve un même argument dans les écrits du Sous-commandant Marcos, militant de la reconnaissance des Indiens du Chiapas comme citoyens à part entière du Mexique.)
4. Capitalisme postfordiste et communication managériale.
4.1. Quand les entreprises décrivent la situation économique dans laquelle leur activité se déroule, elles évoquent une situation de concurrence exacerbée, même de guerre économique, par rapport à laquelle, l’intensification des rythmes de travail, la flexibilité et le lean-management, (pas de stock, pas de temps mort, pas de déplacement inutile, pas de surproduction, pas de défaut, pas de surface morte,) deviennent des indispensables stratégies. Le lean-management permet un abaissement des coûts et surtout une intensification du travail, (jusqu’à provoquer de nouvelles souffrances par usure physique : troubles musculo-squelettiques). L’activité économique dans ce contexte de concurrence et de financiarisation, de forte pression des actionnaires, est présentée comme devant impérativement se diversifier, innover, prendre des risques. Cette course en avant est menée avec une nouvelle conception du lien entre l’entreprise et ses salariés (cadres ouvriers qualifiés et autres). Cette nouvelle relation est due à la flexibilisation, au nouveau type d’évaluation rendu possible par l’informatique et au management de la subjectivité.
4.1.1. La flexibilité imposée aux salariés est une mobilité des salariés, non seulement géographique, mais de poste, ou plutôt de tâches. Beaucoup de salariés n’ont même plus une place fixe attribuée, et ceux qui en ont sont priés de ne pas la personnaliser. Une partie du travail de l’entreprise est externalisée, on recourt à la sous-traitance, ce qui permet l’engagement de travailleurs en situation de précarité et l’émiettement du collectif. Les syndicats ont ainsi moins de prise. A l’interne, c’est une méthode caractéristique de la nouvelle organisation du travail que de décomposer le travail afin de pouvoir transférer une partie des tâches à un personnel moins qualifié, plus précarisé, meilleur marché. La résistance à la perte de qualité qui pourrait s’ensuivre est empêchée par le changement constant d’équipes. Des consultants, qui n’ont justement pas de lien avec l’entreprise, pas de mémoire des apports de chacun, aident à ce que des procédés d’excellence soient récupérés, transformés en nouvelles normes et bonnes pratiques et appliquées à une main-d’œuvre plus jeune, plus précarisée.
4.1.2. L’évaluation se fait en fonction de la réalisation des projets effectués, plutôt qu’en fonction de la qualification par diplômes. Le travail peut être effectué en équipes mais des équipes mises en concurrence entre elles (toyotisme), l’évaluation est continue et inclut des comparaisons délocalisées, grâce à l’informatique ; l’évaluation individuelle est menée parallèlement, et fonctionne aussi comme élément de pression de concurrence entre les salariés. L’évaluation porte l’exigence d’un accroissement continu de productivité. La décomposition du travail en tâches discrètes transfère l’évaluation sur le travail prescrit, mais renforce la distance entre le travail prescrit et le travail réel. En effet, les ergonomes l’ont fait remarquer, la particularité du travail c’est de solliciter l’humain pour faire face aux imprévus, aux pannes, aux dysfonctionnements. En ce sens, il y a toujours un écart entre le travail prescrit et le travail réel. Une vraie conception de l’intelligence collective, selon Yves Clôt, consisterait donc à laisser des espaces de dispute professionnelle, où les pannes sont reconnues et commentées, les solutions confrontées et transmises Mais la recherche de profit incite à transformer sans cesse le travail réel en travail prescrit, et le mode d’évaluation, sur fond d’idéologie de qualité totale, de menace de licenciement, conduit les salariés à cacher les pannes, à truquer les rapports, les exigences étant souvent impossibles à satisfaire.
Un monde de la triche se met en place qui renforce la méfiance et la pression psychique : contournement de certaines mesures de sécurité, justificatifs fictifs (santé) avec risque de compromettre une équipe, ou d’être dénoncé. Le développement de la description du travail en tâches décomposées en vue de gagner en efficience économique est une spirale négative, qui renforce la difficulté des salariés à faire reconnaître les problèmes auxquels ils sont confrontés, à évoquer les pannes et les obstacles, à évoquer la complexité de leur tâche et le poids de leur responsabilité.
Les ergonomes et cliniciens du travail parlent de confiscation symbolique, pour désigner la difficulté grandissante de parler de la réalité du travail, de plus en plus formulée par les responsables de l’évaluation et des contrôles qualité en termes de processus décontextualisés, réalité recouverte par un discours lénifiant, jusqu’au déni.
La flexibilisation et la diversification incessante avec remise des tâches à un personnel moins qualifié a aussi l’effet de démontage des métiers et d’une perte de qualité dans la production, visible pour les salariés, mais effacée des rapports et rendue invisible pour le client. Le salarié se trouve pris entre un constat d’une baisse de qualité et un discours idéologique de qualité totale, pour un client-roi censé être la priorité. Alors que les manuels de management parlent d’une reconnaissance plus profonde car ancrée de manière intrinsèque, l’entreprise vit dans une temporalité où tout attachement au passé est présenté comme une tare, ce qui est incompatible avec la reconnaissance par la transmission des métiers et constitue un mépris des savoirs professionnels.
4.1.3. Le management de la subjectivité : L’augmentation de la productivité en plus des mesures de diminution des coûts en gaspillage et en salaires est recherchée dans l’investissement et la motivation des travailleurs, qui sont appelés à s’identifier à l’entreprise, à y voir le lieu de leur accomplissement personnel, de leur bonheur. Toute une rhétorique est construite autour de cette idée d’une réconciliation du monde personnel et du monde de l’entreprise. Le salarié est incité à une compréhension de soi organisée autour de l’excellence, d’une obligation morale au dépassement de soi, et incité à endosser les échecs et les pannes comme échecs personnels, d’un mauvais management de ses ressources, de son capital de santé physique et psychique. Ainsi la solitude du salarié est grande bien qu’en même temps il lui soit demandé d’être capable de travailler en réseau, d’être connecté. Même plus, chacun a le devoir de respecter son coéquipier au sens de lui rendre possible de donner son maximum, au risque de se voir dépassé et remisé, mais cela est occulté. Aussi le sport alimente-t-il l’imaginaire des managers, sport qui réunit les idées d’équipe, de dépassement de soi, d’effort consenti et d’agressivité pour la victoire.
Mais la rentabilité d’un travailleur dépend autant des modifications sur le marché et de la manière dont les actionnaires et dirigeants décident de réagir par la diversification que de la qualité du travail lui-même. Les promesses d’une réalisation de soi dans une carrière sont donc peu ancrées dans la réelle dynamique de l’entreprise, qui se veut braquée sur le futur, débarrassée du poids du passé, prête non seulement à l’oublier mais à en effacer systématiquement les traces.
L’incitation à un investissement total au nom de l’accomplissement personnel, l’idée qu’un bon management de soi permet de se surpasser débouchent sur un déni des limites.
Un spécialiste du management de la subjectivité et de la performance industrielle, Christian Lemoine, affirmait dans ses conférences à des cadres, qui certainement étaient quotidiennement confrontés aux dures exigences d’efficience et de rentabilité :
« 5 règles s’appliquent à tout l’univers : Le rêve est plus important que le réel, il ne faut pas donner le pouvoir aux experts, le métier est plus important que le marché, le plaisir plus important que les compétences, l’élégance (morale) plus importante que le résultat. »
Il affirme sans provoquer de rire ou de question critique : « Quand un groupe humain est en route vers un projet passionnant, il est quatre fois i infatigable, invincible, invulnérable, immortel … Tous les grands inventeurs passionnés vivent jusqu’à 92,7 ans, ceux qui meurent avant font une faute de management. » C’est un personnage pour Zinoviev.
A se demander si l’aliénation culturelle est telle que plus personne ne parvient à voir ou à dire le caractère aberrant, voire absurde de certaines affirmations de ces spécialistes de la réussite.
4.2. Management de la subjectivité et communication pathologique
Pourtant, un des grands thèmes du développement personnel dans le management de la subjectivité est la communication vraie, l’apprentissage, par gestion de ses émotions et de ses peurs, de la vérité et l’honnêteté dans les échanges…Ainsi que l’affirmait Will Schutz dans L’Elément humain « Lorsque les individus gagnent en lucidité personnelle et en estime d'eux-mêmes, ils s'ouvrent davantage aux autres et deviennent plus honnêtes avec autrui. Ils réorientent l'énergie qu'ils utilisaient auparavant pour se défendre et pour dissimuler ou pour gérer des conflits interpersonnels vers un travail plus productif. »[11]
« Je peux dire que j’ai peur de mon patron, d’être rejeté ou des requins. (…) Aussi longtemps que je vois l’autre comme la cause de ma peur, je perds mon temps à essayer de le changer, à le critiquer, à l’éviter, à le détruire, autant d’actions improductives. Une fois que j’ai vu que mes peurs étaient à l’intérieur de moi, je peux travailler à améliorer ma capacité à faire face ou à prendre conscience d’autres choix. De la même manière, le stress ne résulte pas des stresseurs mais de la manière dont j’interprète et je réagis à leurs injonctions. »[12]
Le salarié entrepreneur de soi-même est invité à se comprendre lui-même à partir des instruments de gestion. Le rapport à soi est traité à travers des classifications de personnalité assez rudimentaires et surtout qui fonctionnent comme une détection de qualités et de défauts, utiles ou pas à l’entreprise. Le rapport à autrui est traité comme une technique de meilleure écoute d’autrui, qui est une meilleure adaptation à son interlocuteur, mais en vue d’une plus grande influence. Il s’agit bien plutôt de (se) gérer, que de se comprendre. Le rapport à soi est ainsi objectivé et impliqué dans une communication pathologique où les notions de vérité, d’authenticité, de respect d’autrui sont grevées de doubles significations contradictoires. De gestion de soi appuyée sur la psychologie ou de disciplines parascientifiques comme la PNL, la gestion de soi se transforme actuellement en gestion de la dimension spirituelle, l’investissement dans le travail n’étant pas total si le soi spirituel se dérobe. Ainsi les RH proposent-ils des séances de formation avec référence aux paroles et silences du Dalaï-Lama et autres sagesses orientales, au chamanisme, et pourquoi pas à l’amour évangélique, tout en rappelant que la spiritualité ne s’identifie pas à la religion. Le but reste un investissement total dans l’instant présent, une disponibilité totale à sa tâche. Au salarié de mettre du sens et d’imaginer la cathédrale, puisque les managers se sont emparés de l’histoire des tailleurs de pierre (trois personnes taillent des pierres, la première dit je taille des pierres, le deuxième dit je participe à la construction d’un mur, le troisième, je construis une cathédrale). Le problème c’est que l’organisation actuelle du travail axée sur l’optimisation de l’efficience, ne considère pas le problème du respect de l’usager comme un problème pertinent. La dimension de destination sociale du travail est en fait écartée, bien que l’idéologie d’une économie au service de tous et surtout du client-roi soit particulièrement développée. Il faut séduire le client, l’attraper, pour faire du chiffre. Dans les centres d’appel par exemple, les salariés doivent suivre un script qui leur interdit d’avoir de l’empathie pour un éventuel client fragilisé, mais les contraint à utiliser dans une cécité à l’égard d’autrui et de leurs propres sentiments à utiliser toutes les failles de leur cible pour vendre. Les contrôles qualité sont là pour sanctionner sévèrement celui qui n’aurait pas maîtrisé ses sentiments et serait sorti du professionnalisme. Enfin, que signifie l’investissement spirituel pour celui qui est compromis, au moins comme témoin passif de procédés d’humiliation et de harcèlement d’un collègue, dont il faut se débarrasser pour des raisons d’efficience, compromis dans le déni des transgressions morales ou du code du travail ?
D’une manière générale, c’est l’opposition flagrante entre le contenu du discours managérial et la réalité du travail et du tissu relationnel qui est en jeu et qui met chacun en demeure de participer au mensonge collectif ou de trouver une modalité de résistance. Les salariés sont pris dans un discours qui est un déni des pratiques quotidiennes (déni de l’intensification du travail, déni de la baisse de qualité du travail, déni de la concurrence entre salariés, déni des mesures vexatoires, déclassement et licenciement d’un collège jugé moins rentable). Plus le discours est lénifiant et décalé du réel, plus les rapports seront truqués et masqueront les pannes, par mesure de protection contre les risques de licenciement pour se protéger contre les méfaits de la concurrence et de l’idéologie de la qualité totale, mais plus aussi chacun étant compromis dans le mensonge, le climat sera délétère et le collectif détruit. Mais aussi plus on parle de communication vraie. On pourrait ajouter que le discours managérial clôt ce système de contradictions par le slogan, « pas des mots, des actes. » Le déni est une des formes de communication pathologique.
A ces nouvelles souffrances morales, s’ajoute celle de l’impossibilité de dire la réalité de la souffrance, un type d’interprétation de la souffrance au travail s’étant imposée, qui privilégie la gestion des ressources et la détection de fragilités personnelles. Yves Clot oppose à ce management du stress, appelée aussi gestion des risques psycho-sociaux, la clinique de l’activité, qui engage une réflexion sur le collectif lui-même. Christophe Dejours propose lui une clinique du travail qui permet de nommer la souffrance morale liée à la destruction de l’intersubjectivité et aux conflits intérieurs que suscitent la trahison de soi-même et la pratique de l’injustice. C’est à cette condition dit Dejours que les salariés souffrants se retrouvent comme sujets.
Dans le documentaire, La mise à mort du travail, L’exploitation, on voit des étudiants en sciences de gestion assister aux entretiens avec les salariés en souffrance, dans la clinique du travail de Marie Pezé[13] . Ces étudiants interrogés par Marie Pezé face à ces nouvelles formes de souffrances au travail, déclarent, avec un demi-sourire gêné, que ce dont les salariés se plaignent, c’est ce qu’ils apprennent à faire dans leur école.
4.3. Néomanagement, nouvelles souffrances, pathologie de la communication au 2e palier.
Pour C. Dejours, les pratiques régulières de mensonges, harcèlement, intimidation, mépris par un discours déni, avec le dispositif de l’effacement de la mémoire collective, constituent une banalisation du mal. « Le mal, dans le cadre de cette étude, c'est la tolérance au mensonge, sa non-dénonciation et, au-delà, le concours à sa production et à sa diffusion (p106). Il s'agit d'abord des infractions de plus en plus fréquentes et cyniques au Code du travail (...) Le mal, c'est ensuite toutes les injustices délibérément commises et publiquement exhibées concernant les affectations discriminatoires et manipulatoires aux postes les plus pénibles ou les plus dangereux (…) Le mal, c'est encore la manipulation délibérée de la menace, du chantage et des insinuations contre les travailleurs, en vue de les déstabiliser psychologiquement, de les pousser à commettre des erreurs, pour servir ensuite des conséquences de ces actes comme prétexte à licenciement pour faute professionnelle (p106). Le mal, c'est encore de manipuler la menace à la précarité pour soumettre autrui (p107). Nous qualifions ici de "mal" toutes ces conduites lorsqu'elles sont : 1. érigées en système 2. publiques, 3. banalisées (p107).[14] (…) Commettre l'injustice au quotidien contre les sous-traitants, menacer ceux qui travaillent de licenciement, assurer la gestion de la peur comme ingrédient de l'autorité, du pouvoir et de la fonction stratégique, apparaissent comme une banalité pour les jeunes embauchés qui ont été sélectionnés par l'entreprise (p136).(…) Le recrutement de jeunes diplômés (...), l'absence de transmission de mémoire collective à cause du licenciement des anciens, et l'effacement des traces (…), forment un dispositif efficace pour éviter la discussion sur les pratiques managériales dans l'espace public (p136) (..) constituent une banalisation du mal. »
Certes on pourrait voir cela comme de malheureuses transgressions des normes. Mais il y a plus, car c’est la norme qui est atteinte : « Ce qui est nouveau, c'est seulement le fait que ce système puisse passer pour raisonnable et justifié ; qu'il soit donné pour réaliste et rationnel ; qu'il soit accepté, voire approuvé, par une majorité de citoyens ; qu'il soit enfin prôné ouvertement, aujourd'hui, comme un modèle à suivre, dont toute entreprise devrait s'inspirer, au nom du bien, du juste et du vrai. Ce qui est nouveau donc, c'est qu'un système qui produit et aggrave constamment souffrance, injustice et inégalités, puisse faire admettre ces dernières pour bonnes et justes. Ce qui est nouveau, c'est la banalisation des conduites injustes qui en constituent la trame (ibid. p199). »
Pourtant, Dejours souligne que ces nouvelles méthodes pathogènes de management ne pourraient pas s’exercer sans le consentement des travailleurs ; c’est l’énigme de la servitude consentie ; peut-être que ces nouvelles méthodes de domination qui ne doivent pas leur succès à leur pertinence technique vis-à-vis du travail, doivent leur attrait au supplément de puissance qu’elles octroient.[15]
L’analyse de Dejours nous conduit à la question : le néolibéralisme, le capitalisme postfordiste et son néomanagement va-t-il jusqu’à altérer la communication au deuxième palier[16] , en faisant passer pour légitime ce qui est transgression de l’éthique de la communication ?
5. De la transgression d’une norme à la norme du déni
Pour C. Dejours, la généralisation de l’idéologie du management, avec sa communication fondée sur le déni et l’incitation à participer, au moins comme témoin passif, à des comportements de harcèlement, de déstabilisation psychique, de transgression de principes éthiques fondamentaux et de code du travail, le sans-gêne dans la communication pathologique constitue une banalisation du mal et le passage à une nouvelle norme, à de nouvelles prémisses de la société, qui n’ont plus de dimension éthique, au sens de l’éthique de réciprocité d’une société démocratique, au sens de la reconnaissance d’un lien social fondé sur la parole. La généralisation du modèle managérial au secteur public (Instruction-Santé-Justice-Administration), de son double langage, de ses dénis et de sa rhétorique simplificatrice, renforce ce bouclage au deuxième palier. Elle tend à générer un changement de type 2 mais dans le sens d’une catastrophe.[17] Nous allons tenter de le montrer, ou en tout cas de le suggérer par quelques exemples.
5.1. Les effets du néomanagement dans le secteur public
La mise en place de l’idéologie managériale comme modèle principal de l’organisation du travail humain s’est développée sur une critique de la bureaucratie et du secteur public. Certains sociologues comme Crozier ont supprimé la distinction entre institution et entreprise en les désignant l’une et l’autre par le terme d’organisation et en étendant ainsi les critères de fonctionnement du secteur privé au secteur public. Le rôle alors assigné aux organisations publiques est celui de récolte d’informations, de gestion, voire de formation, au service de l’économie.
Cette nouvelle dénomination, organisation pour institution, en apparence anodine, s’est accompagnée d’une autre transformation de vocabulaire, les services deviennent des prestations ou des produits, les destinataires des clients, plutôt que des élèves ou des usagers. Ces glissements de sens sont nettement présents dans Les accords de Lisbonne de 2000 qui ont clairement assigné à la formation le rôle de contribuer à gagner la guerre économique contre la Chine et de se moderniser en conséquence… Ce nouvel horizon donné à la formation est repérable depuis 2002 dans les textes gouvernementaux sur les finalités de l’école, dans les chartes d’établissement. Ceci a des conséquences sur la manière de modifier les programmes scolaires car la question des coûts et de la masse critique prévaut sur l’enjeu culturel de certains cours ; de plus les méthodes comparatives statistiques, (benchmarking) ont l’avantage de pousser à des décisions sans entamer les débats de fond. On pourrait être étonné que le sport soit devenu une branche de maturité et qu’on accepte des travaux de maturité portant sur le rôle du mental dans les compétitions de tennis, si on ignorait le rôle idéologique que le sport joue actuellement. L’idéologie managériale apparaît aussi dans la récente réforme pour faire du gymnase une formation de qualité, par l’introduction de l’apprentissage autonome, au sens d’apprentissage autodirigé : l’argumentaire en sa faveur a fait référence aux visées économiques de l’OCDE, les arguments pédagogiques surfant sur plusieurs ambiguïtés du mot autonomie. Le benchmarking a permis d’évacuer le grec sans discussion sur le sens de cette discipline dans notre culture et d’éliminer des heures de littérature au profit d’une formation aux certificats de langue, où Shakespeare n’est pas d’actualité. Depuis les accords de Lisbonne les textes sur les finalités de l’école ont été modifiés, introduisant un éloge de l’esprit de compétition, et le champ lexical de l’idéologie managériale : défi, optimisation, challenge, etc.
La pénétration du langage du New Public Management et de ses outils de gestion en ce qui concerne l’école (élève désigné par le terme de client, cours par celui de produit) a aussi eu des effets profonds sur les méthodes d’évaluation et sur la compréhension que le public peut avoir de cette institution. D’institution porteuse d’une conception démocratique liée aux droits humains fondamentaux, de la mission de rendre possible ce lien social et de donner la possibilité d’une autonomie culturelle, elle est devenue service au public, le public considérant qu’il doit pouvoir choisir ce qui lui convient, comme dans un supermarché. Il s’agit plus de satisfaire le client pris entre différentes conceptions du loisir et le souci d’avoir une formation utile et rentable, que de construire des itinéraires formant la distance critique, les connaissances culturelles approfondies. Les directeurs d’école primaire devenus employés municipaux, formés à être des managers supérieurs hiérarchiquement aux enseignants, n’enseignent plus, ou presque plus, mais peuvent diriger plusieurs collèges ; ils ont moins la charge de rendre présentes les finalités de l’école-institution que de répondre aux désirs des parents, en présentant des évaluations unifiées par objectifs et des résultats de contrôle qualité ; tant de contrôles et d’uniformisation utilitaire justifiés par souci d’équité et de respect de l’élève- client. Quant à l’atmosphère de communication, ce n’est plus un paramètre, car, comme chacun le sait, quand il y de la qualité, de la transparence, de l’efficacité, quand les troubles de l’apprentissage et de comportement ont été détectés, les problèmes ont disparu.
Le paradoxe, c’est que la critique de la bureaucratie qui a permis cette soumission du secteur public à l’économie privée débouche sur une nouvelle bureaucratie bien plus pesante, celle du contrôle continu et du benchmarking et qui fonctionne comme obstacle dans la relation avec le destinataire des services. Pourtant l’argument contre le service public était souvent celle de fonctionnaires formant une caste coupée des usagers. La clinique de l’activité d’Yves Clot a montré que les méthodes managériales empêchaient les postières de considérer la complexité et les besoins sociaux des usagers, contraintes de faire du chiffre. Même constat pour les policiers de quartier. D’une manière générale, les travailleurs des services, soins, communication, administration, souffrent de manière particulière du travail empêché.
L’évolution de l’organisation des services publics (santé, droit, administration, éducation) le montre : les changements opérés par l’idéologie antibureaucratique et anti-fonctionnariat, (selon laquelle toute l’administration du secteur public était autrefois caractérisée par son incapacité de changement, par sa rigidité qui la coupe du public et qui la transforme en caste défendant des privilèges, rigidité qui perpétue des procédures coûteuses et inadaptées au monde changeant) ne vont pas comme on l’a prétendu dans le sens d’une gestion plus rationnelle, mais dans le sens du changement d’horizon de la fonction publique : on perd celui du maintien d’un lien social axé sur la reconnaissance et non sur la force, d’un lien social et d’un Etat qui reconnaît sa limite dans les droits fondamentaux des personnes, dans le double principe de la liberté et de la réciprocité, on le remplace par celui d’une conquête des marchés et de la course concurrentielle. La temporalité institutionnelle d’un service public attaché à un cadre juridique démocratique (respect des personnes et réciprocité) n’est pas la temporalité néolibérale de l’instantanéité, de l’effacement de la mémoire, de l’oubli des principes au nom des circonstances. Les outils issus de la pensée managériale sont tellement réducteurs quant à la conception de la communication réduite à de l’information, qu’ils sont non seulement inadaptés, mais destructeurs des relations avec les usagers, que ce soit dans les soins, dans la pédagogie ou dans l’administration. Cela génère une souffrance tout à fait spécifique des professionnels de santé par exemple, qui non seulement sont empêchés dans leur travail relationnel, mais sont impliqués dans des pratiques qu’ils ressentent comme une sorte de violence ou de déni de dignité du patient.
La généralisation du modèle managérial au secteur public est en effet une introduction d’un système d’évaluation du travail qui aplatit celui-ci en le réduisant à des prestations discrètes mesurable dans le temps. Cette objectivation élimine du tableau la dimension relationnelle qui elle exige une autre temporalité que la prestation définie comme intervention objective dans le monde des faits.
La conception simplifiée de la communication managériale mise en place dans les bibliothèques a conduit à la suppression du service de reddition des ouvrages empruntés. Les usagers rendent le livre à une borne, au lieu de pouvoir discuter avec la bibliothécaire de ses impressions de lecture. Mais il peut en sortant choisir entre 3 smileys, content, neutre, pas content, pour exprimer ses impressions profondes. C’est un usager néolibéralement respecté, il a le choix.
5.2. L’affaissement de la raison.
Sans avoir le temps de développer, je suggère que ce changement d’horizon concerne aussi la raison qui est poussée dans une voie instrumentale et qui fait de la raison la carricature d’elle-même.
Cela peut aller jusqu’à l’instrumentalisation et la déformation idéologique des connaissances scientifiques (par exemple l’utilisation des connaissances sur le cerveau par l’OCDE pour justifier une nouvelle conception de la formation où l’élève se fixe des objectifs et tente de les atteindre avec l’aide d’un coach, l’école n’étant plus considérée comme le lieu privilégié de la formation. En fait cette conception de la formation ne découle pas de ce que les nouvelles connaissances en neurosciences nous apprennent, mais d’une décision politique d’organiser la formation pour qu’elle soit le plus favorable à l’économie : c’est l’idée d’une société de la connaissance où chacun prend en charge aussi économiquement la tâche d’être employable et adapté au marché de l’emploi, flexible. L’instrumentalisation de la raison se traduit par une mise à plat de la communication réduite à l’information, une accentuation des conceptions positivistes en psychologie, un affaissement de la connaissance dans des perspectives idéologiques de contrôle. Ceci est manifeste par exemple dans les programmes de prévention de la délinquance, avec questionnaire sur les troubles de la conduite pour tous les enfants de trois ans.[18]
5.3. Exemple de généralisation de la pensée réifiée et de la communication plate.
Isabel Roskam[19] , professeur de psychologie du développement à l’Université catholique de Louvain,- apparaît dans le film documentaire L’Enfance sous contrôle…On la voit évaluer un enfant considéré comme difficile pour repérer un trouble du comportement, en lui faisant passer un test de frustration. Elle affirme : « Ce qui nous intéresse, c'est s'il adopte un comportement particulier, différent de celui des enfants de son âge. On voit bien que Fabio est différent d'un enfant en contrôle. Il bouge sur sa chaise, il se lève et se rassied, il rouspète, il râle, il dit que ce n'est pas juste, il ne veut plus jouer et refuse de continuer. Sur le plan non verbal, il se manifeste en tapant du poing, il soupire, il met sa tête dans ses mains. Il fait des mouvements du tronc. C'est ce qui amène à ce qu'on code 5. Sur notre échelle de 1 à 5, on va considérer qu'une agitation normale, dans le contrôle, c'est une agitation qui est autour de 2,5. Mais un enfant clinique qui a de vrais troubles du comportement, il se démarque des enfants en contrôle, car la moyenne qu'il obtient, dans la situation de frustration, elle est loin de la moyenne du groupe contrôle, mais on ne peut dire ça que parce qu'on l'a comparé à des enfants du même âge, placés dans la même situation. » Isabelle Roskam parle aussi de la colère de cet enfant, de ses affects très négatifs, puisqu’il crie non, quand il se voit perdre pour la 4e fois. Pourtant cet enfant après avoir dit de vigoureux non au mauvais sort, et avoir tapé sur la table, se prend la tête dans les mains et dit d’une toute petite voix : « ce n’est pas juste ». Pourquoi cette phrase est dite ainsi, ce qu’elle signifie, à qui elle est adressée, qui est là pour l’entendre, sont des questions éliminées d’avance ; ce n’est pas plaçable dans le tableau. Cet enfant reste codé colérique, avec affect négatif grave .
L’observation de l’enfant consiste à décomposer son attitude en éléments objectifs indépendamment du contexte et du sens de sa conduite. L’enfant croit jouer, se réjouit et exprime sa déception, attend peut-être une réponse, de l’empathie, à défaut d’un sort favorable, mais est livré à sa solitude.
A quel champ sémantique recourir pour décrire une attitude et pour en saisir le sens ? A-t-on le droit de désigner le balancement d’un enfant qui espère gagner par le terme « mouvements du tronc » ? La quête des troubles de comportement se présente non comme quête de sens d’une conduite, mais comme constatation d’un fait avec mesure (écart statistique). Pour Isabelle Roskam, c’est cela qui garantit la scientificité de son étude…On peut douter de la valeur d’une démarche si aveugle à son objet d’étude.
L’évolution des classifications psychiatriques, (DSM III-V) va aussi dans le sens d’une classification justifiée statistiquement et permettant l’uniformisation des soins considérés comme prestations et utilisables dans des politiques de prévention des troubles et de contrôle social. Le pas suivant est en train d’être franchi avec la classification R-doc, qui prétend pouvoir s’affranchir d’une classification appuyée sur les données cliniques, les symptômes tels qu’ils apparaissent dans une relation thérapeutique, mais ne s’appuyer que sur des données objectives neurologiques, biochimiques. La maladie psychique n’est plus thématisée comme transformation de l’être-au-monde, de la relation au temps, à autrui, à l’espace, etc.
5.4. Retour à la perspective existentielle et au problème du changement
C’est à travers une esquisse d’analyse du film De Bon matin de Jean-Marc Moutout que je voudrais terminer cette réflexion sur la communication pathologique, l’aliénation et la reconnaissance, ce qui me permet de relier mon analyse du néomanagement à la perspective existentielle sur le travail.
C’est l’histoire d’un homme, Paul Werther haut cadre dans une banque, qui dans sa jeunesse a fait de la coopération en Afrique, qui a un fils et un filleul africain. Homme consciencieux, il s’est fait peu à peu happer par la vie professionnelle au détriment de sa vie familiale. Vers la cinquantaine, après avoir pris la défense d’un collègue injustement accusé, il subit mesures vexatoires et déclassement, reproches de mettre de la mauvaise ambiance dans l’entreprise et voit le jeune homme qu’il venait de former prendre peu à peu sans scrupule sa place. Il essaie de mettre sur pied une résistance collective, en vain. Il va décider d’un acte de justicier en tuant un bon matin le chef responsable de sa dégringolade et le jeune grimpion sans scrupule. Le film commence par la journée du double meurtre, on voit Paul Werther, se lever, se laver les dents et regarder son crachat couler dans le lavabo, se rendre au travail, dans un calme apparent, calme froid de la détermination, puis la violence du double meurtre. Lors du trajet, moment fugace de sensibilité à autrui, une fillette qui pleure, le touche. Pendant l’attente de l’arrivée des policiers, moment où il va se suicider, image que l’on voit vers la fin du film, toute sa vie se déroule à nouveau dans sa tête : on voit le piège dans lequel il s’est laissé prendre, la lente détérioration de la communication avec son fils et sa femme. La découverte que l’attente de reconnaissance dans sa vie professionnelle était un marché de dupe a débouché sur le constat que sa vie privée est aussi atteinte par un abandon des valeurs d’attention à l’autre, de mutualité, de sollicitude. La question se pose alors : que faire d’un tel échec, qui devient l’échec d’une vie ? La possibilité d’une interprétation religieuse de l’échec est suggérée dans le film : au moment de l’humiliation professionnelle la plus profonde qui déclenche la crise, Paul Werther va méditer dans une Eglise regarde un vitrail et l’inscription, Je suis l’Alpha et l’Oméga. Un bref extrait de l’oratorio de Händel, Israël en Egypte accompagne la méditation. Le soir venu, il craque, terrassé, Sa femme le retrouve couché par terre, nu, le prend dans ses bras comme dans une piéta. Mais la possibilité de changement que cette scène suggère est écartée semble-t-il ! Le lendemain, (c’est en fait le début du film) il se dirige vers l’entreprise pour tuer les responsables de l’injustice et de la maltraitance. Désigner le scandale, reprendre la main. C’est à ce moment qu’on le voit se laver les dents, et suivre du regard le crachat couler dans le trou du lavabo… Image d’un regard sans distance. Presque imperturbable, les pleurs de la petite fille le sortent un instant de la voie unique qu’il suit, il va commettre son « acte de justicier ». La construction du film accentue la clôture de la temporalité de cet acte de justice. Néanmoins, le film se termine par la lecture d’une lettre adressée à sa famille, écrite la veille, lettre où il est question de son amour inconditionnel pour eux, de la confiance qu’il leur fait pour rester forts et surmonter leur deuil. La lettre est précédée dans le film de l’image ultra-violente de son suicide. Les mots confiance et amour, la lecture lénifiante qu’il y fait de sa vie de famille comme contrepoids à la vie professionnelle, suscitent un affreux doute sur le sens des mots. Quant à ce qu’aura permis son acte comme prise de conscience chez ses collègues, il y a de quoi être pessimiste : on les voit à la fin du film, alignés dans le silence, attendant la bonne parole du médecin du travail engagé par l’entreprise, spécialiste de la gestion du stress et de l’usage à double sens du mot confiance, comme l’avait durement éprouvé personnellement Paul Werther au début de sa dégringolade professionnelle. Paul Werther voulait provoquer un changement 2, peut-être n’a-t-il fait qu’un changement 1, continuant de circuler dans un monde où l’on ne veut pas perdre la maîtrise et où le sens du mot confiance reste douteux.